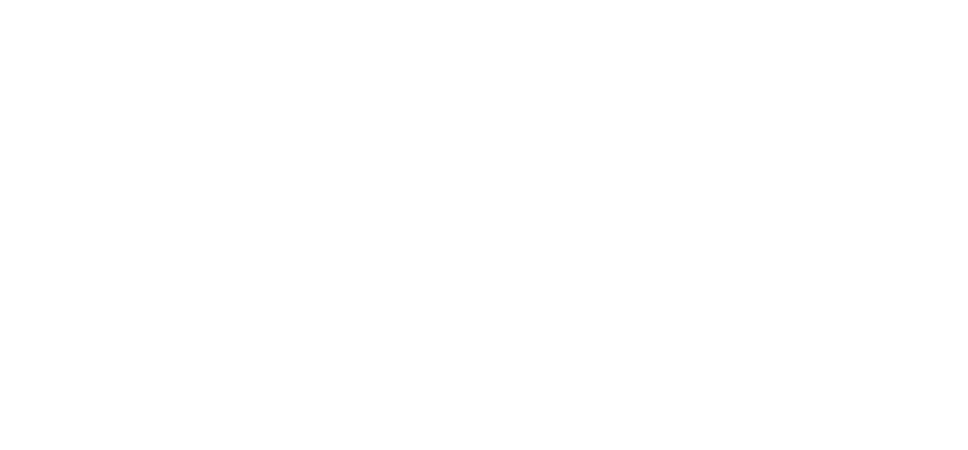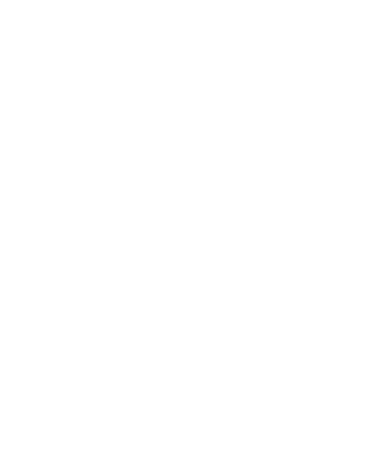This spotlight is only available in French.
Picbois Productions est une entreprise indépendante de production fondée en août 2010 par Karine Dubois, aven le mandat est d’initier, de produire et de diffuser des créations artistiques qui proposent une réflexion sur des réalités sociales ou culturelles.
Qu’est-ce qui vous a motivé à créer Picbois Productions en 2010 ?
Pendant longtemps j’ai pensé produire mes projets dans les compagnies des autres. Je voyais ça gros et compliqué d’avoir ma propre boîte. Et un jour, j’ai réalisé qu’à la quantité de temps, d’efforts, de persévérance que je mettais dans mes projets, je ne voulais plus mettre le logo des autres sur mes projets. J’en ai discuté avec mon chum et il m’a dit qu’il préfèrerait de beaucoup m’épauler si je travaillais pour moi que si je travaillais pour les autres. Et je me suis lancée !
Qu’est-ce qui vous a influencé à devenir documentariste après vos études en journalisme et en sciences politiques ? Une personne ou un évènement ?
Je me rappelle un cours de journalisme télé qui m‘avait un peu traumatisée. C’était le cours où on devait faire de courts topo télé et je ne concevais pas qu’on doive faire parler les intervenants dans des clips de 7 secondes. Et dès qu’on a eu l’occasion de faire des plus longs reportages, j’ai su que j’avais trouvé mon terrain de jeu. J’ai aussi eu le bonheur de travailler dès l’université en équipe avec Catherine Proulx, une réalisatrice avec qui j’ai fait un très grand nombre de projets documentaires ensuite.
Comment choisissez-vous les sujets que vous souhaitez aborder dans vos films ? Considérant votre carrière jusqu’à aujourd’hui, quels sont les points saillants à souligner et les défis auxquels vous avez dû faire face ? Comment avez-vous surmonté ces obstacles ?
Le métier de productrice documentaire est un long parcours à obstacles. Même si on pense qu’on est quelqu’un qui n’accepte jamais un «non» comme réponse, c’est une autre paire de manche quand c’est la vingtième fois que tu te fais dire non. Dans mon cas, ce qui m’a vraiment beaucoup aidé c’est ma gang de productrices amies avec qui je partage des bureaux et une amitié depuis dix ans. Avoir un réseau de femmes fortes et inspirantes avec qui je pouvais ventiler dans les moments difficiles, ça n’a pas de prix.
Étiez-vous en plein tournage quand la pandémie est survenue ? Et maintenant, comment adaptez-vous vos tournages en cours ou ceux à venir ?
Nous avons eu la chance que la pandémie tombe juste entre deux cycles de productions. Nous venions de livrer trois projets et les projets qui étaient en cours ou en train de se mettre en branle ont été relativement faciles à adapter. On a profité du printemps 2020 pour travailler à fond nos projets en développement. Ça a fait du bien. C’est rare qu’on a le luxe de faire presqu’exclusivement du développement. Présentement c’est vraiment un défi parce qu’on a une impression de retour à la normale mais en même temps, les contraintes sanitaires sont encore bien présentes. Notre plus point d’interrogation est pour une série documentaire qui doit se tourner dans 12 pays dans le monde, sachant que l’accès à la vaccination est très inégal d’un pays à l’autre.
Selon vous, quels sont les éléments importants à prendre en compte pour la réalisation d’un film traitant de la justice sociale ou des réalités culturelles ?
Quand nous faisons un film, il y a toujours un souci que les gens qui participent au film reconnaissent leur univers à l’écran. Ça a l’air élémentaire mais ce n’est pas toujours le cas. La réalisatrice Ève Lamont, dans une conférence, m’a fait complètement changer ma perspective sur le rôle des protagonistes dans le processus créatif. Elle n’hésitait pas à inviter ses protagonistes dans la salle de montage pour commenter. Comme productrice, je trouvais ça périlleux comme exercice mais chaque fois que je l’ai fait, ça a soudé l’équipe créative et les gens qu’on filmait et ça a rendu le propos plus fort.
Pour notre premier film, «Un trou dans le temps», un film sur la vie en pénitencier, la réalisatrice avait demandé aux détenus qu’est-ce qu’on devait mettre de l’avant dans la conception sonore. On avait aussi demandé aux détenus de brainstormer le titre du film avec nous. C’est vraiment devenu notre film, à eux comme à nous.
Vous avez abordé un vaste éventail de questions sociales et sociétales qui ont secoué le Québec puis le reste du pays. Votre documentaire novateur Briser le code en est la preuve, particulièrement par votre analyse de la manière dont les communautés autochtones, noires et racisées sont traités au Québec. Il peut être troublant pour une personne de réfléchir sur soi et de se questionner sur sa propre implication dans cette situation. Comment présentez-vous ces sujets afin que votre public ou une personne privilégiée voyant votre film ne se tienne pas sur la défensive ? Comment arrivez-vous à capter l’intérêt de ces personnes ?
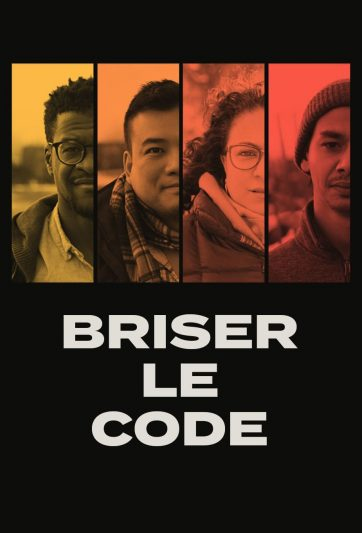
D’abord je tiens à préciser que tout le propos de Briser le code émane d’abord des discussions de ma collègue Marie-Pierre Corriveau et du réalisateur Nicolas Houde-Sauvé avec Fabrice Vil. C’est avec lui et ensuite avec les autres protagonistes du film que nous avons travaillé à bras le corps la notion de «code» exposée dans le documentaire.
Chez Picbois, nous essayons de faire des projets liés aux enjeux de diversité en se tenant sur une très fine ligne : représenter le plus fidèlement possible les obstacles systémiques auxquels font faces les personnes autochtones et racisées et en même temps, faire en sorte que la société majoritaire se sente interpellée par le propos.
Nous avons découvert sur le site web d’un de nos partenaires, l’organisme autochtone Mikana, une expression de sociologie que nous avons adopté comme inspiration. Il s’agit de la «pédagogie de l’inconfort». C’est un concept qui nous guide à la recherche, en réalisation, en montage. Ça implique des questions comme : comment permettre au spectateur de s’attacher au protagoniste pour ensuite être capable de recevoir la charge émotive que sa prise de parole implique ? Comment faire en sorte que le spectateur reste devant sa télé même s’il sent de la culpabilité et qu’il préfèrerait entendre autre chose ? Comment appuyer le propos pour que le public accepte que ce qu’il entend est en totale dissonance cognitive avec tous les biais inconscients qui teintent sa réflexion ?
Bref, on considère qu’on est encore nous-même en plein apprentissage, en constante prise de conscience de l’ampleur de nos privilèges et en collaboration étroite avec des personnes racisées et autochtones pour devenir les meilleurs alliés possibles.
Comment amorcez-vous le débat avec public québécois et quel est d’après vous l’impact de ces échanges ?
Chez Picbois, on réfléchit beaucoup à la notion de production d’impact. C’est une «science» qui n’est pas encore beaucoup mise de l’avant dans le marché québécois. Pour nous, la question du public-cible est centrale. Ce n’est pas une simple question de marketing. C’est une question que nous nous posons dès le départ de chaque projet : à qui voulons-nous parler et dans quel but ? Une question simple mais complexe à la fois.
Ce qui m’interpelle dans la production d’impact c’est de guider le spectateur pour qu’il puisse convertir l’émotion ressentie pendant le film en gestes concrets. Pas nécessairement des gestes militants. Je pense que c’est plus large que ça. L’idée c’est de ne pas laisser baigner le spectateur dans une émotion tellement forte que ça lui laisse une impression d’impuissance, un sentiment qu’il ne peut rien changer.
Concrètement, notre accomplissement récent le plus concret en termes d’impact est le fait que nous ayons été invitées, la réalisatrice Catherine Proulx et moi à la Commission parlementaire sur l’exploitation sexuelle des mineurs pour partager le fruit de notre enquête documentaire Trafic. De parler à un ex-proxénète, dans sa cuisine et qu’il nous dise à l’époque : «Il devrait y avoir des cours d’éducation sexuelle pour tous les jeunes» et de pouvoir ensuite porter sa parole sous forme de court documentaire en le présentant devant une demi-douzaines de députés à l’Assemblée Nationale et de voir ensuite ces propos, mot pour mot, repris dans le rapport de la Commission, c’est précisement pour ce genre de petites victoires que je fais ce métier.
Quels sont les prochains sujets que vous pensez aborder ?
Nous sortons cet automne deux séries web avec Télé-Québec : une qui s’appelle «Décoloniser l’histoire» et une autre sur les 20 ans du 11 septembre. Nous avons également un long-métrage du réalisateur Paul Tom sur les mineurs non-accompagnés au Canada et intitulé «Seuls» qui sort cet automne. Nous travaillons aussi sur un projet balado avec le théâtre Porte Parole, en lien avec une pièce de théâtre documentaire sur la tuerie de Polytechnique. Un autre balado sur le système d’éducation secondaire à trois vitesses au Québec. Une série documentaire internationale sur des collectifs féminins partout dans le monde. Un moyen-métrage sur l’immigration utilitaire au Québec. Je m’arrête ici parce que ce serait trop long mais disons que nous sommes bien occupées !
Que conseillez-vous aux réalisatrices et réalisateurs qui souhaitent aborder les questions sociétales dans leurs documentaires ?
Je pense que de se donner le temps d’observer sans caméra nous a toujours bien servi. Vaincre la peur de manquer quelque chose d’important et se faire confiance qu’en prenant le temps de tisser une relation avant de commencer à filmer, les images tournées plus tard seront encore plus fortes.
La réalisatrice Catherine Proulx avec qui j’ai fait plusieurs projets demande souvent aux protagonistes : «qu’est-ce que le public ne connaît pas ou comprend mal de votre réalité et qu’il devrait savoir». C’est une question magique qui nous a souvent permis de déterminer l’angle avec lequel on allait aborder un sujet.
Sinon question simple mais clé, surtout en 2021 : suis-je la meilleure personne pour traiter de ce sujet, pour prendre la parole dans cette conversation ?

À propos de l’interviewer
La coordinatrice des communications du DOC, Meara Khanna, a interviewé Karine Dubois.
Meara est récemment diplômée de l’école de journalisme de Ryerson et une grande fan de documentaires.
Visitez le portfolio Linked In de Meara pour vous tenir au courant de son travail.